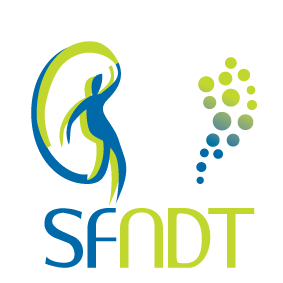Depuis deux ans, le groupe Néphrologie verte de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation (SFNDT) se réunit pour insuffler une démarche environnementale durable dans le milieu néphrologique. Cette préoccupation, qui devrait être universelle, prend un caractère d’urgence au gré des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, entre inondations meurtrières en Europe en 2021 et canicules, sécheresses et incendies estivaux inédits en 2022, pour ne regarder que des zones que nous occupons et qui nous sont proches. Le phénomène du réchauffement climatique est observé sur toute la planète. En 2002, au quatrième Sommet de la Terre à Johannesburg, le président Chirac déclarait : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs… ». Ce constat alarmant a eu peu d’effet pour enrayer le phénomène de plus en plus prégnant. En mars 2022, 80 % des 990 Français interrogés âgés de 18 ans et plus se déclaraient inquiets vis-à-vis de l’environnement et du changement climatique [1]. Le sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a pointé une situation préoccupante [2]. Des organisations non gouvernementales comme le Shift Project font des propositions pour réduire l’impact des activités de santé [3].
Dans le milieu néphrologique et de la dialyse en particulier (activité particulièrement consommatrice d’énergie et de consommables et productrice de déchets), les lanceurs d’alerte environnementaux sont apparus au cours des années 2000. Au Maroc, Tarass et al. [4] ont soulevé la question du recyclage de l’eau et du dialysat usé, une nécessité dans les régions soumises à un fort stress hydrique. John Agar en Australie a partagé son expérience de récupération de l’eau osmosée rejetée et de la production d’énergie solaire dans son centre de dialyse [5]. Il a alerté notre communauté à plusieurs reprises sur la nécessité de mettre en place une démarche vertueuse en termes d’environnement [6, 7]. Malgré cela, une enquête australienne récente sur les pratiques environnementales dans les centres de dialyse a montré un taux de réponse de 30 % et a constaté que les mesures environnementales restent anecdotiques [8]. Enfin, le lien entre chaleurs extrêmes et incidence des maladies rénales est fortement suspecté dans certaines régions du globe [9], ce qui doit être une source de motivation supplémentaire pour la communauté néphrologique.
Après deux ans d’échanges et d’acquisition de données, le groupe Néphrologie verte de la SFNDT livre dans cet article ses premières réflexions, portant sur des aspects techniques et organisationnels (feuille de route), avec l’ambition de contribuer significativement à une meilleure maîtrise des ressources et des nuisances (consommation d’eau, déchets, émission de gaz à effet de serre [GES]) produites par notre activité de dialyse qui, selon les termes de John Agar, contribue de façon disproportionnée à la consommation des ressources et à la production de déchets liés aux soins [10].
Savoir ce que l’on fait ou le recueil des indicateurs
Mesurer ce que l’on fait est la seule façon de mettre en place des mesures correctives pertinentes. Ceci vaut pour toutes les activités humaines et s’applique au domaine de la protection environnementale [11]. En dialyse, trois indicateurs sont facilement accessibles et au centre des préoccupations de durabilité : la consommation d’électricité et la production de déchets liés aux soins, chacune porteuse d’une empreinte carbone significative, et la consommation d’eau, qui a une faible empreinte carbone mais est une ressource essentielle et consommée de façon importante, par l’hémodialyse (HD) en particulier. Le groupe Fresenius a mis en place dès 2005, dans ses unités de dialyse NephroCare en Europe, un recueil trimestriel de ces trois indicateurs rapportés à la séance de dialyse [12] avec fixation d’objectifs ambitieux pour mettre en place les actions correctives afin de les atteindre. La mise en place du recueil a nécessité des investissements en compteurs divisionnaires d’eau et d’électricité afin d’isoler la consommation dévolue à la dialyse. Des responsables du recueil des indicateurs ont été désignés et formés. Entre 2005 et 2018, le suivi a montré une amélioration significative dans tous les domaines. La consommation d’électricité par séance a baissé de 30 % grâce au changement de générateurs d’HD plus économes, au changement des ampoules pour de la basse consommation, à la mise en place de détecteurs de présence et de minuterie, à l’optimisation technique des centrales d’air et à la réduction des surfaces en cas de déménagement ou de construction de nouvelles structures. La consommation d’eau a baissé de 52 % sur la même période en raison des nouveaux générateurs plus économes aussi en matière d’eau, au déménagement de certaines unités dans des structures neuves, et surtout à la mise en service de nouvelles centrales de traitement d’eau. Les osmoseurs sont une source importante de déperdition en raison du rejet à l’égout d’une partie de l’eau traitée qui pouvait atteindre 70 % du volume traité avec les anciennes générations de ces centrales [13]. Actuellement, cette part de rejet s’est réduite aux alentours de 30 %. L’amélioration de la consommation d’eau par séance s’est réduite, dans l’étude de Nephro-Care, de 800 L en 2005 à 382 L en 2018, baisse essentiellement attribuée aux nouvelles centrales de traitement d’eau [12]. Le groupe Néphrologie verte de la SFNDT a mené une enquête sur les traitements d’eau. Sur les 68 unités ayant répondu, un tiers avait des centrales d’eau de 15 ans et plus (figure 1), montrant un potentiel important d’économie d’eau si le choix est fait de centrales d’eau de dernière génération. Enfin, dans l’étude de NephroCare, la production de déchets liés aux soins est passée de 1,8 à 1,1 kg par séance entre 2005 et 2018. Ce résultat a été obtenu par la mise en place d’un registre de déchets, par la formation des soignants et la tenue d’audits réguliers sur les pratiques de tri [12]. Cette expérience délivre une méthode indispensable pour évaluer la situation et améliorer la performance environnementale en HD.
La problématique de l’eau en dialyse
Comme souligné précédemment, la consommation d’eau en HD est très importante pour cette ressource vitale universelle. Ceci a été pointé par Molino-Trivino et al. comme une responsabilité supplémentaire pour les néphrologues, avec ces objectifs : réduire, réutiliser et recycler [14].
Réduire la consommation d’eau
Avoir un traitement d’eau économe
Ce point capital de limiter le rejet de l’eau traitée a été abordé plus haut. Il est fondamental et le plus important levier pour l’économie d’eau.
Reconsidérer la place de la dialyse péritonéale : une bonne idée sur le plan de la consommation d’eau en dialyse
La dialyse péritonéale (DP) est une technique de dialyse moins consommatrice en eau si l’on se réfère à la quantité de dialysat nécessaire pour un traitement hebdomadaire.
En HD standard (trois fois 4 heures par semaine avec un débit de dialysat à 500 mL/min), 360 L de dialysat sont consommés chaque semaine pour traiter un patient. Avec une centrale d’eau de dernière génération, la quantité d’eau nécessaire pour produire les 120 L d’eau ultrapure nécessaire à la fabrication du dialysat par séance est environ trois fois le volume du dialysat, soit 360 L, aboutissant sur une semaine à 1 080 L d’eau par patient traité. En DP continue ambulatoire, sur une base de 6-8 L par jour, la quantité hebdomadaire de dialysat consommée est de 42-48 L. Si on applique le même facteur 3 qu’en HD pour la fabrication des poches de dialysat, le traitement en DP consomme 126-144 L d’eau par semaine. La différence est majeure et doit être prise en compte par les prescripteurs. Il est mis en avant que les poches plastiques de dialysat en DP nécessitent beaucoup d’eau pour leur fabrication (180 L/kg [15]). Cependant, la séance d’HD génère aussi au moins 3 kg de déchets plastiques par semaine (lignes et dialyseurs) en quantité quasi-équivalente aux poches de DP (3,25 kg par semaine). Ainsi, la DP reste nettement plus économe que l’HD en termes de consommation d’eau.
Réduire le débit de dialysat en hémodialyse : jusqu’où pouvons-nous aller ?
Depuis les années 1960, beaucoup de néphrologues prescrivent un débit de dialysat à 500 mL/min ; mais la réduction du débit du dialysat a émergé cette dernière décennie pour répondre à des attentes environnementales et économiques et grâce à l’arrivée de générateurs capables d’adapter le débit du dialysat sur le débit sanguin effectif, appelés « auto-flow » (AF). De façon parfaitement intuitive, plus le débit de dialysat prescrit est élevé, plus le volume de dialysat consommé est important [16]. Pour un dialyseur donné et avec un débit faible de dialysat, augmenter le débit sanguin au-delà de 300 mL/min n’augmente pas l’épuration de l’urée qui atteint un plateau. Cependant, la relation clearance/débit sanguin devient quasi-linéaire pour des débits de dialysat entre 500 et 800 mL/min, avec une amélioration de la clearance majorée avec les augmentations des deux débits dialysat et sanguin [17]. Les auteurs l’expliquent par le recrutement optimal des fibres du dialyseur à débit de dialysat élevé, alors que lorsque le débit est plus faible, il se forme un espace mort de fibres non utilisées pour l’épuration. Par ailleurs, les auteurs montrent chez six patients, avec trois dialyseurs de marques différentes mais de surface identique, que le Kt/Vurée (méthode « single pool ») croît avec l’augmentation du débit de dialysat à 300 (KtVurée : 1,43-1,52), 500 (1,61-1,70) et 800 mL/min (1,70-1,80).
Les résultats cliniques de réduction du débit de dialysat sont contradictoires. Dans l’étude Flugain, Molano-Trivino et al. [18] ont comparé les données d’HD chez 46 patients sélectionnés sur leur poids (< 65 kg), sur deux périodes de quatre semaines avec un débit de dialysat prescrit à 500 et 400 mL/min. L’économie de dialysat a été de 24 L par séance avec un débit à 400 mL/min sans modification significative du Kt/Vurée, du potassium, de la phosphatémie et de la prise de poids interdialytique. Ces données, à première vue rassurantes sur la réduction de 20 % du débit de dialysat, sont le fait d’une étude sur une période courte et sur des patients sélectionnés sur le poids et donc applicable seulement à une minorité de patients. Kult et Stapf [19] ont étudié huit patients avec le même dialyseur à haute perméabilité en polysulfone (surface de 1,4 m2), sur générateurs 4008© en HD standard pendant une semaine alternée avec un générateur 5008© en dialyse standard sans (pendant une semaine) ou avec (pendant une semaine) la fonction AF (l’AF adapte automatiquement le débit du dialysat au débit sanguin effectif). Un facteur à 1,2 appliqué dans cette étude signifie que le débit de dialysat est réglé automatiquement à une valeur 1,2 fois le débit sanguin effectif ; par exemple, un débit sanguin effectif à 300 mL/min avec un débit du dialysat à 360 mL/min. La troisième partie de l’étude a été faite pendant une semaine avec des séances d’hémodiafiltration (HDF) en ligne (avec production du liquide de substitution à partir du dialysat) sur 5008© avec AF et infusion automatique en ligne du liquide de substitution conduite par la machine (fonction Auto-Sub©, AS). Chaque semaine sur 4008© a servi de base pour la consommation de dialysat et d’efficacité de la dialyse. Entre la séance standard sur 4008© et celle sur 5008© avec AF, la consommation de dialysat est réduite de 31,4 % (500 versus 347 mL/min). Dans le même temps, le Kt/Vurée passe de 1,34 ± 0,12 à 1,19 ± 0,08. En HDF avec AF/AS sur 5008©, la consommation de dialysat diminue par rapport à la 4008© de 500 à 377 mL/min (réduction de 19,1 %), malgré le volume de substitution (VS) de 67 mL/min, alors que le Kt/V reste stable (1,30 ± 0,13 versus 1,34 ± 0,12). Ainsi et de façon contre-intuitive, l’HDF avec AF/ AS permet une réduction de consommation du dialysat significative sans altérer l’épuration de l’urée. On peut cependant s’attendre à ce que l’économie de dialysat soit moindre avec les VS actuellement préconisés de l’ordre de 21 L par séance (87,5 mL/min pour une séance de 4 h). Ces données ont été en partie confirmées par Mesic et al. [20] comparant l’HD standard avec l’HDF (AF1,2/AS/VS 18 L/séance) chez 56 patients sur 954 séances. La consommation du dialysat était réduite de 8 % en HDF (113,4 versus 123,2 L) mais le Kt/Vuree était plus élevé en HDF (1,47 ± 0,26 versus 1,42 ± 0,23 ; p < 0,0001).
Ces données incitent à la prudence quant à la réduction du débit de dialysat dans le but de réduire la consommation d’eau. En effet, alors que l’étude HEMO n’a pas montré un avantage de survie d’un Kt/Vurée élevé uniquement chez les femmes [21], une étude récente de cohorte du registre Rein a rapporté une relation linéaire entre la survie et le Kt et le Kt/Vurée [22]. Si le débit de dialysat est prescrit dans le but de réduire la consommation d’eau, la surveillance du Kt/V doit être rigoureuse pour ne pas altérer le pronostic du patient. L’intérêt de l’HDF « on-line » apparaît intéressant mais reste à démontrer avec les volumes convectifs cibles actuels.
Régénérer le dialysat en ligne : « Back to the future? »
Entre 1973 et 1994, un générateur appelé le REDY (REcirulation of DialYsate) a été largement utilisé (6 millions de séances) avec une consommation d’eau de 6 L par séance [23]. Le dialysat était régénéré par une cartouche « multicouches » (charbon activé, uréase, phosphate et oxyde de zirconium), chacune d’elles ayant la capacité de retenir un ou des composants du dialysat usé. Cette modalité a été interrompue après la survenue d’intoxications aluminiques attribuées aux cartouches et n’a pas été réétudiée à ce jour. Elle mérite sûrement une réévaluation en particulier pour les pays à fort stress hydrique. La régénération du dialysat est actuellement utilisée dans les modèles de « dialyse portable », que ce soit avec le WAK (Wearable Artificial Kidney) de Victor Gura [24] en HD ou le AWAK (Automated Wearable Artificial Kidney) en DP [25]. Les possibilités techniques sont importantes même si leur application à l’échelle de la dialyse va demander des investissements importants en recherche et développement.
Réutiliser l’eau du rejet d’osmose
John Agar en Australie est celui qui a attiré l’attention de notre communauté sur la nécessité de récupérer l’eau du rejet d’osmose [5]. Ce rejet a les qualités d’une eau potable mais présente une salinité qui peut limiter sa réutilisation. Dans son établissement, cette eau récupérée à la sortie de l’osmoseur est stockée dans un réservoir au 8e étage de la structure et redistribuée par gravité au service de stérilisation (production de vapeur), pour les sanitaires, le ménage et l’entretien des espaces verts [13]. L’AURAL Lyon a profité de son installation dans de nouveaux locaux en 2003 pour alimenter les sanitaires avec l’eau rejetée par l’osmoseur [26]. Un autre usage innovant est celui de l’aquaponie rapportée dans un centre de dialyse de Malaisie [27]. L’eau rejetée par l’osmoseur alimente en continu des réservoirs d’élevage de poissons et de plantations fournissant poissons et légumes pour la consommation des patients et de l’équipe soignante. Pour l’irrigation et l’arrosage des espaces verts, et pour répondre aux nouvelles normes en matière de nettoyage avant stérilisation, Abarkan et al. [28] ont récemment proposé une méthode de dessalement basée sur l’électrodialyse, plutôt économe en énergie.
Réutiliser le dialysat usé
C’est une problématique importante pour les pays à fort stress hydrique et l’une des premières publications de cette problématique vient du Maroc par Tarrass et al. [4]. Les auteurs ont montré que le dialysat usé a une conductivité trop élevée pour satisfaire aux normes de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture/l’Organisation mondiale de la santé (FAO/OMS) pour l’irrigation, et des concentrations inadéquates en phosphates et sulfates, entre autres. Les auteurs ont comparé le coût de revient du traitement du dialysat usé par nanofiltration ou osmose inverse. En 2008, ce coût était calculé à 0,70 $, soit 30 % de moins que le prix moyen de la désalinisation de l’eau de mer. Peu de solutions applicables ont été proposées depuis, mais la recherche continue pour valoriser le dialysat usé [29]. L’expérience des vols spatiaux habités servira peut-être la cause de la réutilisation de l’eau du dialysat usé. Actuellement, l’urine des astronautes est recyclée à 85 %, ce qui est suffisant pour un séjour dans la station spatiale internationale mais encore insuffisant pour des missions habitées sur Mars [30].
La dialyse et l’empreinte carbone
Dans la publication rapportant l’évolution des indicateurs de consommations d’eau et d’électricité et de production de déchets liés aux soins par séance de dialyse, Bendine et al. [12] ont calculé l’économie de production de GES en équivalent de tonnes de carbone (t CO2e). Entre 2005 et 2018, une économie de 92 400 t CO2e a été induite par la réduction de la consommation d’électricité, 10 000 t CO2e par la réduction des déchets liés aux soins, et 17,5 t CO2e par la réduction de la consommation d’eau. Cette économie représente l’équivalent de 11 500 vols en avion autour de la Terre.
Le bilan carbone des unités de dialyse a été encore peu étudié. Les études sont résumées dans le tableau 1. En Australie, Lim et al. [31] (tableau 1) ont estimé l’empreinte carbone annuelle par patient à 10,2 t CO2e en relation avec l’HD, alors que l’empreinte annuelle des citoyens australiens est en moyenne de 18 t CO2e par individu. Les trois postes à l’empreinte la plus importante étaient respectivement les médicaments (35,7 %), le matériel (23,4 %) et l’énergie (18,6 %). Le transport vers l’unité de la dialyse représentait 8,8 % des émissions, contre 25,8 % pour Connor et al. [32]. D’autres calculs du bilan carbone des unités de dialyse ont été publiés. Au Maroc (tableau 1), le bilan a été retrouvé à 5,1 t CO2e par patient et par an avec une part plus importante pour l’énergie (28 %) [33]. Les résultats sur une unité de dialyse à Newcastle au Royaume-Uni ont été présentés à l’Université d’été 2022 de la SFNDT par Costelloe [34] : le bilan carbone correspondait à 3,1 t CO2e par an et par patient, majoritairement lié au transport des patients (27,2 %) et à l’énergie (31,5 %). Les différences des émissions de carbone liées à l’énergie peuvent s’expliquer par l’origine de l’électricité plus ou moins carbonée (fossile, renouvelable, nucléaire, etc.). En France, l’empreinte carbone d’un centre lourd et d’entraînement à la dialyse de l’ARTIC 42 de Saint-Etienne, réalisée sous l’égide du groupe Néphrologie verte de la SFNDT, est en cours d’analyse.
| Référence | Pays, Année | Caractéristiques de la structure | Émissions patients/an (t CO2e) | Trois principaux postes d’émission : % du total |
|---|---|---|---|---|
| Connor et al. [32] | Angleterre, 2008 | Unité de dialyse de l’hôpital de Dorset 225 patients en HD et 54 patients en DP | 7,1 | Achats de biens et servicesa : 46,7 % Transport patients et personnels : 25,8 % Électricité et chauffage : 14,2 % |
| Lim et al. [31] | Australie, 2011 | Unité de dialyse satellite de la banlieue de Victoria 12 patients en HD (3 séances de 4 h par semaine) | 10,2 | Consommables, dispositifs médicaux : 59 % Électricité et chauffage : 18,6 % Transport patients et personnels : 8,8 % |
| Mtioui et al. [33] | Maroc, 2019 | Unité de dialyse du CHU de Casablanca 80 patients en HD (3 séances de 4 h par semaine) | 5,1 | Électricité : 28 % Achats de biens et servicesb : 27 % Transport patients et personnels : 22 % |
| Sehgal et al.c [35] | États-Unis, 2020 | 15 centres en Ohio 13 965 séances d’HD par centre (3,8 h en moyenne par séance) | 8,6d | Électricité et gaz naturel : 42,6 % Transports patients et personnels : 28,3 % Gestion des déchets : 17,6 % |
| Costelloe [34] | Angleterre, 2022 | Unité de dialyse de l’hôpital de Newcastle | 3,1 | Énergie : 31,5 % Transport des patients : 27,2 % |
Médicaments, dispositifs/consommables médicaux, examens complémentaires, papeterie, restauration et aliments, blanchisserie, construction, informatique, eau, buanderie.
bMédicaments, dispositifs/consommables médicaux, papeterie, fourniture de bureau, service de maintenance.
cL’étude utilise une méthodologie basée sur l’analyse en cycle de vie.
dEn considérant que chaque patient bénéficie en moyenne de 156 séances annuellement (3 séances hebdomadaires).
Tableau 1
Comparaison des études sur l’évaluation de l’empreinte carbone de l’hémodialyse.
Les disparités importantes de ces différents résultats, de 3,1 à 10,2 t CO2e ne sont pas surprenantes. Sehgal et al. [35] ont retrouvé des disparités allant jusqu’à un facteur 3 dans l’émission des GES dans 15 unités de dialyse de la même organisation au sein de l’État de l’Ohio. Les auteurs soulignent l’importance de l’identification de ces disparités afin de corriger les sources d’augmentation de l’émission des GES. Elles appellent aussi à une uniformisation des méthodes de calculs. En pratique, nous ne disposons pas de facteur d’émission adapté pour certaines sources spécifiques du secteur de la santé, en particulier les médicaments, les équipements et les dispositifs médicaux. Actuellement, nous sommes contraints d’utiliser des facteurs génériques fournis par l’Agence de la transition écologique (Ademe), dont l’incertitude varie de 50 % à 80 %. Ce facteur, basé sur une approche monétaire, est ainsi le même pour l’ensemble des médicaments quelle que soit la spécialité. En pratique, cela signifie que le coût carbone unitaire d’un euro de paracétamol est considéré comme identique à celui d’un euro d’héparine, ce qui ne correspond pas à la réalité car les lieux et processus de fabrication ne sont pas les mêmes (l’empreinte carbone de la production d’un médicament est en grande partie liée à l’intensité carbone de l’électricité produite dans le pays de fabrication). Il en est de même pour l’ensemble des dispositifs médicaux d’une part, et des équipements médicaux d’autre part. Le coût carbone unitaire d’un dialyseur (par euro dépensé) est différent de celui d’un gant stérile mais considéré dans les analyses utilisant un facteur d’émission générique comme équivalent. En cause, le manque d’informations concernant les analyses de cycle de vie pour la majorité des médicaments et des dispositifs médicaux dont dépend le système de soins. Pour s’affranchir de ce biais, il est nécessaire d’établir des facteurs d’émissions spécifiques (pour chaque classe de médicaments, chaque type de dispositif et d’équipement médical). Cette démarche passe obligatoirement par une étroite collaboration avec les fabricants et les industriels pour une meilleure évaluation des flux physiques en jeu et une plus grande transparence concernant l’analyse du cycle de vie des produits vendus au secteur afin de faciliter la réalisation du bilan carbone.
Concernant les différentes modalités de dialyse, Connor et al. [32] ont étudié le bilan carbone de huit modalités d’HD en centre et à domicile, dont les résultats sont résumés dans le tableau 2. L’empreinte carbone est deux fois plus élevée avec l’HD quotidienne longue nocturne à domicile, avec générateur standard, comparée à l’HD conventionnelle en unité de dialyse (7,2 versus 3,8 t CO2e par patient et par an). L’utilisation de cycleurs à bas débit permet de réduire de 65 % l’empreinte carbone par rapport à une dialyse à domicile avec un générateur standard. En dialyse péritonéale, une estimation n’incluant pas l’empreinte du transport des solutions, ni les médicaments, a été estimée à 1,4 t CO2e par patient et par an [36].
| Modalités | Bilan carbone annuel par patient (t CO2e) |
|---|---|
| Hémodialyse en unité de dialyse | |
| 3 x 4 h par semaine, générateur standard | 3,8 |
| Hémodialyse à domicile | |
| 3 x 4,5 h par semaine, générateur standard | 4,3 |
| 5 x 4 h par semaine, générateur standard | 5,1 |
| 3 x 7 h par semaine, nocturne générateur standard | 3,9 |
| 6 x 7 h par semaine, nocturne générateur standard | 7,2 |
| 5,5 x 3 h par semaine, cycleur bas débit | 1,8 |
| 6 x 7 h par semaine, cycleur bas débit | 2,1 |
Tableau 2
Empreinte carbone de différentes modalités d’hémodialyse, d’après Connor et al. [32].
Enfin, certaines initiatives contribuent à réduire l’empreinte carbone de la dialyse. La plus marquante actuellement est le Centre François Berthoux de l’ARTIC 42 à Saint-Priest-en-Jarez. La construction de cette nouvelle structure de 4 500 m2 et opérationnelle depuis 2020 a eu comme ambition et objectif d’installer soignants et patients dans un bâtiment « passif » à consommation énergétique limitée à des triples vitrages, à la géothermie, et à la récupération de chaleur produite par l’activité humaine et technique. C’est le premier centre de dialyse labellisé « maison passive » au niveau européen [37], avec une consommation énergétique à moins de 15 kWh/m2 par an. À noter que cette construction n’a reçu aucun soutien financier de la part des autorités de santé.
Les autres problématiques
Les obligations faites à l’industrie
Les industriels travaillent à réduire l’impact environnemental des produits qu’ils fabriquent avec cette notion de « cycle de vie », c’est-à-dire leur impact de la conception à la destruction. Cet indicateur est devenu récemment une obligation règlementaire [38]. Par exemple, on trouve sur internet (mots clés « dialyzer life cycle ») l’amélioration de 42 % de cet impact pour une nouvelle génération de dialyseur en termes d’utilisation des ressources terrestres, de production de polluants pour l’eau et l’air, et de produits toxiques et/ou cancérigènes. Dans le même ordre d’idée, des fournitures « durables » sont actuellement accessibles pour le fonctionnement des unités de dialyse à base de polymères transformés (adjonction de matière végétale au polymère) ou recyclés, colligés par Van Holder et al. [39]. Ces produits sont utilisés pour la fabrication des emballages, des connecteurs, du matériel à perfusion, des masques, des contenants de solutés, etc. Les auteurs citent les entreprises qui les produisent et les vendent afin de permettre d’orienter les achats « durables » des structures de dialyse.
La sobriété numérique
Dans le bilan carbone des centres de dialyse, l’empreinte liée aux réseaux informatiques reste assez floue car elle ne prend en compte que les GES émis pour la conception, la fabrication et l’acheminement du matériel, sans prendre en compte les flux numériques et le stockage des données sur serveurs. L’éducation de tous les acteurs des centres de dialyse est importante en matière d’utilisation de courriel. Dix pour cent de l’électricité mondiale est consommée par les « data centers », dont une moitié sert au refroidissement des installations. Un mail avec une pièce jointe de 1 MB génère 11 g d’équivalent carbone [40], équivalent à la production d’un sac plastique. Selon Ovoenergy [41], si chaque Britannique s’abstenait une fois par jour de répondre « thanks » au cours d’un échange par courriel, l’économie serait de 16 433 t CO2e par an, équivalent de 81 152 vols entre Londres et Madrid faisant émerger la devise : « Think before you thank ». Ceci doit inciter à réduire les mails inutiles en particulier quand il y a un nombre important de personnes en copie et des pièces jointes qui sont réadressées inutilement dans les réponses ou les transferts. Ne pas laisser les ordinateurs en veille en fin de travail est aussi une mesure salutaire.
Par ailleurs, une autre technologie que le Wifi est prometteuse, le Lifi (Light Fidelity) [42]. Basée sur les ondes lumineuses des ampoules LED plutôt que sur les ondes électro-magnétiques du Wifi classique, le Lifi a l’avantage d’être plus rapide, mieux sécurisé contre les cyberattaques et moins consommateur d’énergie, mais n’assure que les communications intra-centre sur le périmètre de l’éclairage LED.
La réutilisation des dialyseurs
La réutilisation des dialyseurs est une pratique que les Européens ont interrompue dans les années 1990 pour des raisons de sécurité. Elle reste cependant utilisée dans les pays à bas revenus et même encore récemment aux États-Unis (24 % en 2012 [43]). Une importante organisation de dialyse comme DaVita présente sur son site les avantages et inconvénients de la réutilisation et donne au patient le choix de réutiliser ou non le dialyseur [44]. La réutilisation des dialyseurs représente un potentiel théorique de réduction de l’empreinte carbone du traitement mais l’analyse du processus de nettoyage et du reconditionnement du filtre nécessite d’être bien étudiée en termes de produits polluants et de consommation d’eau et d’énergie. Connor et al. [32] ont calculé une réduction d’empreinte carbone de 9,7 % avec dix utilisations du même filtre. Une telle mesure ne pourra se faire qu’avec les associations de patients, utilisateurs en première ligne du dispositif. Une autre façon originale de réemployer les dialyseurs est de les utiliser pour filtrer les eaux usées. C’est ce que fait la société NUFiltration© en Israël sur le plateau du Golan connu pour son aridité. Dix pour cent des dialyseurs utilisés dans le pays seraient ainsi recyclés selon Caroline de Malet du Figaro [45].
Les obligations réglementaires françaises et européennes
Dans leur revue extensive, Van Holder et al. [38] ont mis en avant l’ensemble des mesures prises par la Communauté européenne ayant trait à la protection de l’environnement et qui touchent de près ou de loin le domaine de la néphrologie et de la dialyse (European Green Deal, Farm to Fork Strategy, Life 2021-2027, Horizon Europe 2021-2027) de même que les programmes orientés vers la santé avec un volet prévention pouvant réduire l’incidence des maladies rénales chroniques (Beating Cancer Plan, EU4Health). En France, depuis le 1er janvier 2022, les entreprises ayant des locaux de taille supérieure à 1 000 m2 sont tenues de déclarer leurs données bâtimentaires et leur consommation énergétique dans le but de réduire ces dernières. Ainsi, des mesures sont prises au niveau des organisations gouvernementales ou supra-gouvernementales, sans doute trop lentement pour certains d’entre nous. Dans le cadre du Ségur de la santé, 150 postes de conseillers et de coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé (CTEES) ont été créés pour accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans la réduction de leur empreinte carbone et leur transition écologique [46]. La situation géopolitique actuelle avec la guerre en Ukraine vient compliquer la situation énergétique mais permet d’accélérer la réflexion autour de la sortie des énergies fossiles à forte émission de carbone. Nous devons mobiliser la communauté néphrologique pour mettre en œuvre des mesures allant dans le sens de l’histoire environnementale.
Les acteurs de la Néphrologie verte
La protection de notre environnement dans le domaine de la santé, et de la néphrologie en particulier, est l’affaire de tous. Pour être efficace, il faut être ambitieux et unis. Le groupe Néphrologie verte de la SFNDT peut et doit servir de moteur dans la communauté en entraînant dans la réflexion tous les acteurs sur la base d’un guide en cours de finalisation. Ce document permettra de mobiliser aussi bien les soignants que les patients, les autorités de santé, les directions, les industriels, les techniciens biomédicaux, les médecins, les pharmaciens et les agents d’entretien. Les domaines de chacun sont résumés dans le tableau 3. En premier lieu, les autorités de santé doivent impulser une politique proactive en matière d’environnement dans les structures de soins, en poursuivant la mise en place de contraintes environnementales obligatoires, en finançant les projets innovants et en récompensant les initiatives et améliorations dans le domaine de l’environnement à travers l’incitation financière à la qualité (IFAQ). Par ailleurs, la Certification HAS (Haute Autorité de santé) 2020 en France n’a pas inscrit la maîtrise du développement durable dans les critères impératifs, ce qui ne donne pas à cette problématique une priorité importante au sein des établissements qui travaillent à l’amélioration des pratiques en vue de la visite des experts.
| Autorités de santé |
| Définir des obligations réglementaires en matière d’environnement des services de soins en néphrologie, dialyse et transplantation. Valoriser les initiatives environnementales dans les incitations financières à la qualité (IFAQ). Mettre en place à court terme des appels à projets environnementaux financés de façon pérenne. |
| Directions d’établissements |
| Faire de la sauvegarde de l’environnement une culture d’entreprise en désignant des référents « environnement » (« green team ») et en mettant en place des actions de formation obligatoire à destination de tous les salariés. Être formé à la responsabilité sociétale de l’entreprise. Mettre en place des indicateurs environnementaux avec des cibles définies et une démarche d’amélioration par des audits réguliers. Connaître le bilan carbone de la structure et mettre en place un plan pour le réduire. Choisir les fournisseurs d’énergie sur des critères environnementaux. Choisir les autres fournisseurs en fonction de leur démarche environnementale. Mettre en place une vraie politique pour encourager et favoriser les déplacements bas-carbone des salariés. Dialoguer avec les transporteurs des patients pour réduire l’empreinte carbone des allers/venues sur la structure. Prendre en compte l’empreinte carbone des déplacements de l’encadrement. Faire de l’environnement une priorité dans les projets de l’entreprise. Mettre en place une charte d’utilisation de l’outil informatique compatible avec la protection de l’environnement. Favoriser la formation en distanciel et e-learning. En cas de projet de déménagement ou de nouvelle structure faire de l’aspect environnemental une priorité dans la conception. |
| Industriels de la pharmacie et de la dialyse |
| Communiquer de façon transparente sur leur démarche environnementale entrepreneuriale. Communiquer de façon transparente sur l’empreinte carbone des médicaments et le cycle de vie des produits. Assurer une logistique bas-carbone. Utiliser des matériaux issus de recyclage. Favoriser le recyclage des appareils en fin de vie. |
| Néphrologues/Pharmaciens/Responsables biomédicaux |
| Être formé aux pratiques durables et à la sauvegarde de l’environnement. Prendre en compte la problématique environnementale dans la prescription des médicaments et des techniques de dialyse en cherchant à privilégier les techniques de domicile. Évaluer la possibilité de réduire la consommation du dialysat. Étudier le gain environnemental de la réutilisation des dialyseurs. Étudier les possibilités d’utilisation de la télémédecine pour le suivi des patients et réduire les déplacements. Connaître le bilan carbone des médicaments et dispositifs médicaux dans le choix d’approvisionnement. Connaître le bilan carbone de offres logistiques. Orienter les choix des produits de désinfection en tenant compte de leur impact environnemental. Assurer le recyclage des emballages. Favoriser la distribution centrale du concentré acide permettant de limiter les contenants en plastique et améliorer l’ergonomie des soignants. Pratiquer des audits sur la production des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Évaluer/Surveiller le rejet de la centrale de traitement d’eau. Évaluer et proposer les possibilités de recyclage de l’eau rejetée par le traitement d’eau. Étudier les possibilités de production locale d’énergie, comme les panneaux solaires. Veiller à l’entretien/réglage des centrales d’air consommatrice d’énergie. Privilégier la formation continue en ligne plutôt qu’en présentiel. |
| Soignants/Agents de service/Secrétaires médicales |
| Être formé à la sauvegarde de l’environnement. Être formé au tri des déchets y compris sur le coût environnemental de l’élimination des DASRI. Participer à l’optimisation des transports des patients. Inclure dans l’éducation thérapeutique une formation pour la sauvegarde de l’environnement à destination des patients. Assurer « les petits gestes » d’économie en eau et en électricité « comme à la maison ». Faire preuve de sobriété dans la consommation de matériel (impression de documents, matériel à usage unique, etc.). Être force de proposition en matière de sauvegarde de l’environnement dans les activités quotidiennes. |
| Patients |
| Être formé à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre de l’éducation thérapeutique. Accepter le transport partagé en l’absence d’épidémie. Participer à des protocoles de recherche à visée environnementale, comme la réduction du débit de dialysat ou sur la réutilisation des dialyseurs. |
Tableau 3
Les acteurs de la Néphrologie verte.
Les directions des établissements de soins ont une grande responsabilité en matière environnementale. Depuis 2011, le concept de la responsabilité sociétale de l’entreprise est mis en avant. Il doit être développé et les directions doivent se l’approprier, d’autant que cette démarche peut avoir un impact financier intéressant pour la structure par les économies qu’elle peut générer. Ce leadership est indispensable pour qu’une évolution vertueuse dans le domaine environnemental se développe. De par la certification HAS récurrente, les établissements de soins sont organisés sur le plan de la qualité et de la gestion des risques et ce département est, dans la plupart des cas, à même de conduire le suivi du projet environnemental. Il est aussi important de désigner des acteurs spécifiques dans ce domaine sous forme d’une « green team » multi-professionnelle formée et motivée pour créer la dynamique indispensable au changement de paradigme. Enfin, comme on le voit dans le tableau 2, tous les acteurs du soin et du fonctionnement de la structure de santé doivent être formés à la cause environnementale. C’est la responsabilité de la direction de veiller au déploiement de ces formations.
Les industriels impliqués dans l’approvisionnement en matériel et médicaments doivent faire preuve de leur engagement dans ce domaine car ils seront tenus, à partir du 1er janvier 2023, de fournir le bilan carbone de leurs produits dans tous les marchés passés avec les établissements de soins. Les néphrologues doivent progresser dans la connaissance de l’impact environnemental de ce qu’ils prescrivent. C’est un défi difficile. Ils doivent piloter aussi la recherche qui peut permettre d’améliorer l’impact environnemental. La réflexion nécessaire sur la réutilisation des dialyseurs en est un bon exemple. Les pharmaciens, par leur connaissance des médicaments, leur implication dans le suivi des traitements d’eau, par leur approche de la logistique et leurs fréquentes responsabilités en matière d’hygiène, sont des acteurs incontournables de la réflexion. Les techniciens biomédicaux connaissent très bien les équipements dont ils ont la charge. Ils doivent favoriser le recueil des indicateurs. Ils peuvent être force de propositions techniques pour réduire l’impact environnemental de la dialyse ou du fonctionnement de la structure.
Les soignants, de même que les secrétaires médicales et les agents de service par leur implication, sont des acteurs indispensables aux mesures environnementales (tri des déchets, transports des patients, consommation d’eau, d’électricité et de consommables, etc.). Ces actions ne se feront pas sans l’aide des patients qui doivent devenir pro-actifs dans la réflexion. Tous ces acteurs doivent être fédérés autour d’une « green team » pluridisciplinaire assurant la conduite du projet environnemental et son évaluation.
Conclusion
Même si la tâche est immense et peut parfois paraître insurmontable, elle est nécessaire et urgente tant les conséquences du réchauffement climatique paraissent graves selon le rapport du GIEC [2] et le rapport du Shift Project consacré au système de santé [3]. Il faut aussi garder à l’esprit que beaucoup des investissements nécessaires pour entamer la démarche écologique peuvent s’avérer être des économies à plus long terme et qu’en mettant toute notre pratique à plat et en la rendant plus vertueuse, nous pouvons améliorer la qualité des soins due à nos patients (air plus pur, moins de plastiques à particules toxiques, etc.). La prise de conscience actuelle offre une opportunité pour la mettre à profit et valoriser la réflexion et la mise en place de mesures permettant de relever le défi. La SFNDT en a pris connaissance précocement, avec son groupe Néphrologie verte qui travaille à la rédaction d’un guide d’actions de développement durable en dialyse. Elle veut préparer notre communauté à réduire son empreinte environnementale avant que les autorités ne nous les imposent. Nous le devons à la société en prenant une part active à la sauvegarde de notre environnement tout en maintenant une prise en charge optimale pour les patients. Tous les efforts nécessaires et attendus pour l’environnement ne peuvent qu’être bénéfiques pour tous en réduisant la pollution de l’air et l’exposition aux particules toxiques produites par notre consommation effrénée.
Liens d’intérêts
Charles Chazot a été salarié de Fresenius Medical Care jusqu’en septembre 2021. Les autres auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec l’article.