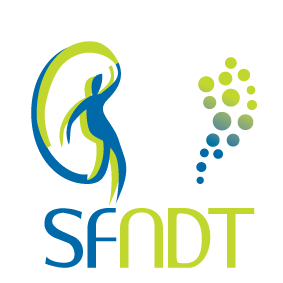“Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health”☆
Les conséquences des changements climatiques pour la santé nécessitent une mobilisation urgente de tous les acteurs de santé. L’appel de 40 rédacteurs en chef de revues anglophones ne peut être ignoré par la presse médicale francophone.
L’assemblée générale des Nations-Unies, en septembre 2021, a rassemblé tous les pays, en ce moment critique, afin de mettre en place une action collective pour lutter contre la crise environnementale globale. Ils se rencontreront à nouveau au sommet sur la biodiversité de Kunming en Chine et à la Conférence pour le climat de Glasgow, Royaume-Uni (COP26). En amont de ces réunions pivots, nous – les rédacteurs de revues de la santé du monde entier – appelons à une action urgente pour garder l’augmentation de la température globale au-dessous de 1,5 °C, arrêter la destruction de la nature et protéger la santé de nos concitoyens.
La santé de tous est déjà altérée par l’augmentation globale de la température et la destruction de la nature, une situation sur laquelle les acteurs de santé attirent l’attention depuis des décennies [1]. La science est sans équivoque : une augmentation de la température globale de 1,5 °C au-dessus de la moyenne de la période préindustrielle et la perte continuelle de la biodiversité risquent d’être une catastrophe pour la santé, et il sera impossible de revenir en arrière [2], [3]. En dépit de la préoccupation mondiale qu’entraîne légitimement la pandémie de COVID-19, nous ne pouvons attendre qu’elle se termine pour réduire nos émissions.
Cet éditorial, qui veut refléter la gravité de la situation, est publié dans plusieurs revues à travers le monde. Nous nous unissons pour reconnaître que seuls des changements fondamentaux et équitables de nos sociétés sont susceptibles de nous faire revenir en arrière.
Les risques pour la santé d’une augmentation de la température au-delà de 1,5 °C sont maintenant bien établis. En vérité, aucune augmentation de la température n’est sans conséquence. Au cours des 20 dernières années, la mortalité associée à une température excessive, chez les personnes de plus de 65 ans, a augmenté d’au moins 50 % [4]. Les températures élevées sont associées à une fréquence plus grande d’épisodes de déshydratation et de perte de fonction rénale, de cancers de la peau, d’infections tropicales, de troubles mentaux, de complications de la grossesse, d’allergies, de morbidité cardiovasculaire et pulmonaire, ainsi que de la mortalité [5], [6]. Les personnes vulnérables, incluant les enfants, les personnes âgées, les minorités ethniques, les populations pauvres et les personnes malades, sont touchées de façon disproportionnée [2], [4].
Le réchauffement général contribue aussi à la baisse potentielle du rendement des cultures principales, qui a diminué de 1,8–5,6 % depuis 1981 ; ce qui, combiné avec les conséquences des températures extrêmes et de l’appauvrissement des sols, contrarie les efforts de lutte contre la malnutrition [4]. La prospérité des écosystèmes est essentielle pour la santé humaine, et la destruction généralisée de la nature, des habitats et des espèces réduit la sécurité de l’eau et de l’alimentation, et augmente le risque de pandémies [3], [7], [8].
Les conséquences de la crise environnementale touchent, de façon disproportionnée, ces pays et communautés qui en sont les moins responsables et sont les moins capables d’en limiter les effets. En réalité, aucun pays, quel que soit son niveau de richesse, ne peut se protéger de ces impacts. En laisser les conséquences toucher, de façon disproportionnée, les plus vulnérables entraînera plus de conflits, d’insécurité alimentaire, de migrations forcées, de zoonoses – avec des implications sévères pour tous les pays et communautés. Comme pour l’épidémie de COVID, nous ne serons pas globalement plus résistants que notre maillon le plus faible.
Des augmentations de la température globale au-dessus de 1,5 °C accroissent le risque de faire basculer les systèmes naturels, ce qui pourrait enfermer le monde dans un état d’instabilité aiguë. Cela pourrait perturber, de façon critique, notre capacité à réduire les préjudices et à prévenir un emballement catastrophique des changements environnementaux [9], [10].
1. Des objectifs globaux ne suffisent pas
De façon encourageante, de nombreux gouvernements, institutions financières et le monde des affaires sont en train de fixer des objectifs d’émissions net-zéro, certains pour 2030. Le coût des énergies renouvelables diminue rapidement. Beaucoup de pays visent à protéger au moins 30 % des terres et océans mondiaux pour 2030 [11]. Ces promesses ne sont pas suffisantes. Les objectifs sont faciles à établir, mais difficiles à atteindre. Ils doivent être associés à des plans crédibles à court et long termes pour accélérer le développement de technologies plus propres et transformer nos sociétés. Les considérations des programmes de réduction d’émissions en matière de santé ne sont pas adéquates [12]. Le fait que les augmentations de la température au-dessus de 1,5 °C commencent à être vues comme inévitables, voire acceptables, par des leaders de la communauté mondiale, devient un sujet d’inquiétude [13]. De même, les stratégies actuelles pour réduire à net-zéro les émissions de gaz à effet de serre d’ici le milieu du siècle supposent que le monde aura acquis les moyens de les extraire de l’atmosphère, ce qui est peu vraisemblable [14], [15]. Cette réaction insuffisante signifie que l’augmentation de la température risque d’être bien au-dessus de 2 °C, une perspective catastrophique pour la santé et la stabilité environnementale [16]. De façon critique, la destruction de la nature n’a aucune commune mesure avec le facteur climat dans la crise et chacun des objectifs globaux pour contrecarrer la perte de la biodiversité a échoué [17]. La crise est environnementale et globale [18].
Les professionnels de la santé sont unis avec les scientifiques spécialisés dans l’environnement, les acteurs du monde des affaires et bien d’autres pour dire que cette situation n’est pas inévitable. Il doit être fait plus et cela dès maintenant – à Glasgow et à Kunming – et dans les années qui suivront. Nous faisons appel aux professionnels de la santé qui ont déjà soutenu les appels à une action rapide [1], [19].
L’équité doit être au centre de cette action globale. Contribuer de façon équitable à l’effort global signifie que les engagements de réduction doivent tenir compte de la contribution cumulative et historique de chaque pays à ces émissions, de même que de sa contribution actuelle et de sa capacité à y répondre. Les pays les plus riches doivent cesser leurs émissions plus rapidement, les réduisant pour 2030 au-delà de ce qui est proposé aujourd’hui [20], [21] et arrivant à net-zéro avant 2050. Des objectifs similaires et des actions urgentes sont nécessaires contre la perte de la biodiversité et, plus largement, contre la destruction de la nature.
Pour atteindre ces objectifs, les gouvernements doivent changer fondamentalement l’organisation de nos sociétés et économies, ainsi que nos modes de vie. La stratégie actuelle d’encourager les marchés de troquer les technologies sales pour des plus propres ne suffit pas. Les gouvernements doivent intervenir pour soutenir les changements des systèmes de transport, des villes, de la production et de la distribution de la nourriture, des investissements financiers, des systèmes de santé et bien plus. Une coordination globale est nécessaire pour s’assurer que les technologies plus propres ne se développent pas au prix de plus de destruction environnementale et d’exploitation humaine.
De nombreux gouvernements ont fait face au danger de l’épidémie de COVID en mobilisant des financements sans précédents. La crise environnementale demande une réponse identique en urgence. Des investissements colossaux seront nécessaires, bien au-delà de ceux qui sont prévus ou accordés où que ce soit dans le monde. Mais ces investissements auront un retentissement considérable et positif sur la santé et l’économie. Cela inclut des métiers de forte valeur ajoutée, une pollution aérienne réduite, une activité physique augmentée, un milieu de vie et une alimentation de meilleure qualité. L’amélioration de la qualité de l’air à elle seule apportera des bénéfices qui couvriront facilement le coût de la réduction des émissions [22].
Ces mesures amélioreront aussi les déterminants sociaux et économiques de la santé, dont la piètre situation a accru la vulnérabilité de certaines populations à la pandémie de COVID-19 [23]. Mais les changements ne peuvent être obtenus par le retour à des politiques d’austérité destructrices ou l’acceptation de disparités de richesse et de pouvoir à l’intérieur et entre les pays.
2. Coopérations charnières des nations riches pour faire plus
En particulier, les pays qui sont plus que les autres à l’origine de la crise environnementale doivent faire plus pour aider les pays de faible ou moyen revenu à bâtir des sociétés plus propres, plus saines et plus résilientes. Les nations à PIB élevé doivent se rencontrer et aller encore au-delà de leur engagement extraordinaire pour verser 100 milliards de dollars par an, comblant les manques à gagner en 2020 et augmentant leur contribution jusqu’en 2025 et au-delà. Le financement doit être distribué de façon égale entre réduction et adaptation, incluant l’amélioration de la résilience des systèmes de santé.
Le financement devrait se faire par le biais de subventions plutôt que de prêts, permettant de construire des capacités locales et une réelle autonomisation des communautés ; il devrait s’accompagner d’une annulation des dettes élevées, qui sont une contrainte pour les agences de tant de pays à faible revenu. Un plan Marshall pour des financements supplémentaires doit être lancé afin de compenser les pertes et destructions inévitables causées par les conséquences de la crise environnementale.
En tant que professionnels de santé, nous devons faire tout notre possible pour faciliter la transition vers un monde durable, résilient, plus juste et plus sain. En parallèle à une action pour réduire les destructions de la crise environnementale, nous devons activement contribuer à leur prévention globale et agir sur les racines de la crise. Nous devons devenir des leaders mondiaux qui font prendre connaissance et continuent à éduquer les autres sur les risques de la crise pour la santé. Nous devons travailler ensemble à créer un système de santé respectueux de l’environnement avant 2040, sachant que cela signifie changer nos pratiques cliniques. Des institutions de santé ont déjà remplacé des produits d’énergie fossile pour plus de 42 milliards de dollars et d’autres devraient suivre leur exemple [4]. La plus grande menace pour la santé publique est l’échec permanent des leaders de ce monde à garder la température globale au-dessous de 1,5 °C et à restaurer la nature.
C’est urgent : des changements en profondeur de la société doivent être faits et devraient conduire à un monde plus juste et plus sain. Nous, rédacteurs de revues de la santé, appelons les gouvernements et leaders à agir, faisant de 2021 l’année où le monde a changé sa course.
Déclaration de liens d’intérêts
Les auteurs ont lu et compris la politique du BMJ sur la déclaration des liens d’intérêt et ont déclaré ce qui suit : FG, membre du comité exécutif de la UK Health Alliance on Climate Change et administrateur de l’Eden Project ; RS, président de Patients Know Best, actionnaire de l’United Health Group, consultant pour Oxford Pharmagenesis, et président de la Lancet commission on the value of death.
Remerciements
Cet éditorial a été publié simultanément dans plusieurs revues internationales. La liste complète des titres peut être consultée à l’adresse : https://www.bmj.com/content/full-list-authors-and-signatories-climate-emergency-editorial-september-2021.
Références
- [1]
- In support of a health recovery. https://healthyrecovery.net.
- [2]
-
Intergovernmental Panel on Climate ChangeSummary for policymakersGlobal warming of 1.5 °C. An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (2018)
- [3]
-
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity Ecosystem ServicesSummary for policymakers: the global assessment report on biodiversity and ecosystem services(2019)
- [4]
-
N. Watts, M. Amann, N. Arnell, S. Ayeb-Karlsson, J. Beagley, K. Kristine Belesova, et al.The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crisesLancet, 397 (2021), pp. 129-170, 10.1016/S0140-6736(20)32290-X
- [5]
-
R.J. Rocque, C. Beaudoin, R. Ndjaboue, L. Cameron, L. Poirier-Bergeron, R.A. Poulin-Rheault, et al.Health effects of climate change: an overview of systematic reviewsBMJ Open, 11 (2021), p. e046333, 10.1136/bmjopen-2020-046333
- [6]
-
A. Haines, K. EbiThe imperative for climate action to protect healthN Engl J Med, 380 (2019), pp. 263-273, 10.1056/NEJMra1807873
- [7]
-
United Nations Environment Programme International Livestock Research InstitutePreventing the next pandemic: zoonotic diseases and how to break the chain of transmission(2020)
- [8]
-
IPCCSummary for policymakersSpecial report on climate change and land (2019)
- [9]
-
T.M. Lenton, J. Rockström, O. Gaffney, S. Rahmstorf, K. Richardson, W. Steffen, et al.Climate tipping points – too risky to bet againstNature, 575 (2019), pp. 592-595, 10.1038/d41586-019-03595-0
- [10]
-
N. Wunderling, J.F. Donges, J. Kurths, R. WinkelmannInteracting tipping elements increase risk of climate domino effects under global warmingEarth Syst Dyn Discuss, 12 (2020), pp. 601-619
- [11]
- High Ambition Coalition. https://www.hacfornatureandpeople.org.
- [12]
- Global Climate and Health Alliance. Are national climate commitments enough to protect our health? https://climateandhealthalliance.org/initiatives/healthy-ndcs/ndc-scorecards/.
- [13]
-
Climate strikers: open letter to EU leaders on why their new climate law is surrenderCarbon Brief (2020)
- [14]
-
M. Fajardy, A. Köberle, N. MacDowell, A. FantuzziBECCS deployment: a reality checkGrantham Inst Brief Paper (2019)
- [15]
-
K. Anderson, G. PetersThe trouble with negative emissionsScience, 354 (2016), pp. 182-183, 10.1126/science.aah4567
- [16]
- Climate action tracker. https://climateactiontracker.org.
- [17]
-
Secretariat of the Convention on Biological DiversityGlobal biodiversity outlook 5(2020)
- [18]
-
W. Steffen, K. Richardson, J. Rockström, S.E. Cornell, I. Fetzer, E.M. Bennett, et al.Sustainability. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planetScience, 347 (2015), p. 1259855, 10.1126/science.1259855
- [19]
- UK Health Alliance. Our calls for action. http://www.ukhealthalliance.org/cop26/.
- [20]
-
Climate Action TrackerWarming projections global update(2021)
- [21]
-
United Nations Environment ProgrammeEmissions gap report 2020UNEP (2020)
- [22]
-
A. Markandya, J. Sampedro, S.J. Smith, R. Van Dingenen, C. Pizarro-Irizar, I. Arto, et al.Health cobenefits from air pollution and mitigation costs of the Paris Agreement: a modelling studyLancet Planet Health, 2 (2018), pp. e126-e133, 10.1016/S2542-5196(18)30029-9
- [23]
-
L. Paremoer, S. Nandi, H. Serag, F. BaumCOVID-19 pandemic and the social determinants of healthBMJ, 372 (2021), p. n129, 10.1136/bmj.n129
- ☆
-
Cet éditorial est la traduction d’un éditorial paru en anglais dans le BMJ du 06 septembre 2021, publié sous licence CC-BY, sous la référence BMJ 2021 ;374 ; doi : https://doi.org/10.1136/bmj.n1734. Pour citer cet article, utiliser la référence originale : BMJ 2021 ;374 :n1734. La traduction en français a été réalisée par la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation (Pr. Maryvonne Hourmant).